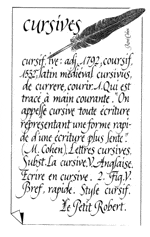|
Prendre la vie à contre-poil :
|
|
|
| Françoise Salamand-Parker fait partie du collectif de Filigranes. Elle vient de publier aux éditions Manoirante à Seynod La griote de Montpellier, un recueil de poèmes où elle croise l’expérience d’un Africain immigré en France et d’une Française atteinte d’un handicap, tout en évoquant les quartiers et les atmosphères de Montpellier, la ville où elle habite.
Depuis quand l’écriture t’a-t-elle accompagnée ? F.S-P : Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours écrit. Quand j’étais petite et que l’écriture manuscrite m’était encore plus physiquement pénible que maintenant, j’écrivais des petites poésies, des contes. Mes camarades d’école s’en sont aperçues et j’ai appris à monnayer mes talents contre des bonbons ou des mistrals gagnants, friandises que j’adorais. J’écrivais donc à 10 ans sur commandes, des compliments d’anniversaire ou de fête des mères, des odes au mois de mai. L’expérience artistique se doublait d’une épreuve physique puisque j’écrivais à la main en tenant mon stylo si fort pour le stabiliser que mes ongles entraient dans les paumes de mes mains et que la pointe bic en trouait le papier. Mais je ramassais avec plaisir mon petit succès d’estime et mes confiseries. Heureusement, je suis née dans une période où on avait inventé la machine à écrire et dès 6 ans, dès que mon handicap a été correctement diagnostiqué, les kinés rééducateurs de l’hôpital de Garches où j’ai séjourné pendant un an m’ont mise devant un clavier. Et là, ça a été la découverte de la liberté, je pouvais écrire sans trop souffrir, les autres pouvaient me lire sans s’abîmer les yeux en essayant de déchiffrer des caractères hiéroglyphiques, et je pouvais espérer continuer mes études. Lire, écrire, apprendre telles étaient les clefs de mon indépendance, à moi dont la partie motrice du cerveau avait été asphyxiée à la naissance, et qui ai un contrôle très imparfait sur mon corps : élocution difficile, marche déséquilibrée, gestes incoordonnés. Que faire avec un moteur aussi capricieux quand on voudrait être un bolide… Avancer cahin-caha. Un voyage imaginaire F.S-P : Quand j’ai 12 ans, un accident de voiture me cloue sur un lit d’hôpital pendant trois mois. Petite bonne femme à peine entrée dans l’adolescence, je me vois contrainte à apprendre à marcher pour la deuxième fois et toujours dans la douleur. Mais la chambre d’hôpital devient atelier d’écriture. Avec mes parents et ma sœur également hospitalisés, nous décidons dans notre immobilité de faire un voyage en bateau. Mon père dessine une carte de l’Europe qu’il épingle au mur avec un petit bateau mobile qui nous sert de curseur, apporte dictionnaires et encyclopédies et nous voilà embarqués de Salon-de-Provence où se situait cet hôpital-là vers le Nord de la Norvège. Ce n’est pas qu’une anecdote : ce récit, écrit sous forme de livre de bord où nous transformions la réalité de notre quotidien de malades en escapade maritime, avait une contrainte. Il fallait utiliser des matériaux réels, (la météo, la force du vent, les repas) pour les inclure dans notre voyage imaginaire. Quand nous sommes sortis de l’hôpital, nous avions atteint les Shetland et j’avais vu à l’œuvre la force de l’écriture. Voir la vie en mots Ensuite je n’ai jamais cessé d’écrire bien qu’ayant une pratique irrégulière de l’écriture. Je vois la vie en mots comme d’autres la voient en images. L’irrégularité de ma pratique tient peut-être à une paresse innée ou plutôt à une difficulté d’avoir les conditions matérielles nécessaires à la pratique elle-même : une chaise, une table à la bonne hauteur, un clavier pour les écritures de plus d’une page. Même si j’en ai l’envie et le désir, je ne peux pas écrire n’importe où et n’importe quand. J’ai des carnets parce que je ne peux pas transporter un ordinateur partout où je vais. J’ai des carnets pour une écriture courte, parcellaire. Le temps qui m’est imparti pour une écriture manuelle étant limité, je vais à l’essentiel, je note des images, je fais des photographies de mots (que je réussis mieux qu’avec un appareil photo). Ces mots deviendront le point d’ancrage pour un texte plus long, ou un fragment inséré dans une autre toile textuelle ou resteront dans leurs pages à moins que je les retrouve au hasard d’une relecture aléatoire de ces carnets qui s’entassent. Parfois les mots griffonnés l’ont été dans des conditions tellement inappropriées (sur les genoux où la main tremble, dans les transports souvent) que je n’arrive pas à me relire et c’est un autre texte qui jaillit.
Peux-tu nous présenter brièvement F.S-P. : Chaque individu a son parcours. Chaque personne handicapée aussi. Je considère comme une chance d’avoir pu évoluer dans un milieu ordinaire, d’avoir pu être scolarisée dans des écoles « normales », grâce à la ténacité conjuguée de mes parents et de mes institutrices, puis d’avoir pu intégrer une école « normale » supérieure. La contrepartie étant que j’ai pris le racisme institutionnalisé en pleine gueule sans protection. Quand l’administration a refusé que j’utilise la machine à écrire pour passer l’agrégation (alors que je l’avais utilisée pour tous mes autres examens et concours), elle m’a simplement empêchée d’avoir un poste de chercheur au CNRS. A chaque succès correspond un doute puis un rejet de la part d’instances sans visage qui n’ont qu’un objectif, ne pas faire de vagues, ne pas créer de précédent. Ne pouvant pas avoir cette place de chercheur en sociologie de la littérature au CNRS, je suis devenue conservateur de bibliothèques en Université où je garde un lien avec le monde de l’étude et de la recherche. Mais dans ce milieu aussi, le racisme allié à la peur de la nouveauté et au manque d’audace prévalent et je n’ai jamais pu avoir les responsabilités que je demandais ni les promotions qui vont avec. Mais c’est un métier de « passeur » de savoirs et en cela, il me convient.
L’écriture est-elle une façon de combattre F.S-P. : La frustration et la révolte, pour moi comme pour les autres, sont toujours présentes et impérieuses. J’ai publié des articles « coups de gueule », des « témoignages » et ce que j’écris dans Filigranes depuis 1993 est une écriture de combat autant que de métier. Quand je dis « métier », c’est ce merveilleux « travail » sur la forme, qui me plait tant. Jouer avec les mots, explorer les formes contraignantes, comme la rime, le nombre de syllabes, la répétition, tout cela est comme un fantastique jeu de construction, très jouissif pour moi qui ne peux pas monter un cube sur un autre. J’ai ainsi écrit une pièce de théâtre qui a été montée par une troupe d’amateurs, des lettres, des textes à quatre mains, des sonnets, des odes en alexandrins, des témoignages. Ce qui nous ramène à la problématique du handicap. Car avant d’être un objet de désarroi pour les yeux des autres, des gens ordinaires, il est une suite de contraintes et de limitations pour la personne qui en fait l’expérience. Dans le handicap comme dans l’écriture, il faut déjouer ces contraintes pour trouver un modèle inédit de liberté. Il y a de grands écrivains qui sont de grands malades ou handicapés (Proust, Joe Bousquet, Apollinaire). Leur écriture atteint l’universel, le plus grand dénominateur commun de l’humain, au moment où l’autobiographie rejoint l’expérience partagée et comprise par tous. En faisant des recherches pour cet entretien, je me suis aperçue qu’il y avait aucune étude sur le sujet de Cursives : le rapport entre handicap et écriture chez les écrivains qui sont atteints d’un handicap ou d’une maladie incurable. Ce serait un sujet de thèse inédit.
Dirais-tu que le handicap a nourri, F.S-P. : Le handicap est une forme de l’expérience humaine. Mais il n’est aussi qu’un élément de ma biographie. Souvent, il est difficile de montrer qu’on peut être autre chose. Le regard des autres pose un doute sur vos diplômes, vos réussites, vos compétences et voudrait vous enfermer dans un ghetto, une catégorie, vous calibrer comme des tomates. Si vous restez dans des milieux ou des habitats qui concentrent les « blessés de la vie », il sera plus dur de faire admettre vos talents. Si vous rejetez cette fraternité d’expérience comme je l’ai fait une partie de ma vie, vous vous voilez la face et vous rejetez une partie de vous-même. L’équilibre est délicat à tenir. Le même processus se retrouve dans l’écriture : ne pas parler du handicap, c’est faire fi d’une expérience unique et fertile mais on ne peut pas avoir une écriture libérée si on tourne en rond autour de ce détail biographique. Quoi qu’il en soit, le handicap est très souvent le thème de mes écritures tant universitaires que personnelles. Il est abordé soit directement comme dans le roman qui n’a pas trouvé d’éditeur et qui s’intitule L’Ami des Passages, roman d’apprentissage, récit des vacances d’été d’une jeune fille handicapée qui passe de la Terminale à l’Université, de l’enfant à la femme, de l’innocence à la souffrance avec la découverte de ses désirs et des freins mis à son accomplissement. Mais j’abordais le même thème de biais, on peut dire, quand à 15 ans, j’écrivais La Petite Marine, là aussi une jeune fille qui veut embarquer sur un chalutier comme mousse et qui n’a pas d’autre alternative que de se faire passer pour un garçon. Ou quand j’ai choisi de faire ma thèse sur les écrivains noirs-américains rejetés par leur propre pays. Ce choix n’était pas conscient à l’époque mais avec le recul du temps je vois que j’ai toujours écrit sur des révoltes et des actions de résistance, histoire de prendre la vie à contre-poil. L’homme étant meilleur, plus fort, plus riche que ceux qui l’oppriment, la résistance voire l’impertinence est le seul discours à tenir. C’est aussi la fonction de l’humour : mettre à distance ce qui blesse. C’est peut-être pour ça que dans ces temps de pensée unique, l’humour est aussi censuré.
L’écriture contient-elle F.S-P. : Je ne peux pas savoir si l’écriture m’aide à transcender mon handicap. Je n’ai pas de point de comparaison. Je n’ai jamais été non-handicapée. Je n’ai de l’expérience du monde que celle d’une personne diminuée dans ses possibilités physiques. Ecrire est à la fois un bonheur et une souffrance, mais ce sentiment est partagé par tous les écrivains. Bonheur de transcender son ego pour le mettre à distance, inventer un autre monde, dire la colère ou la joie dans un langage transmissible et compris par tous. Souffrance du mot qui ne vient pas, de la page rebelle, du découragement de l’imperfection. Dans les moments de crise où je n’arrive plus à faire sens de cette douleur inutile, oui, écrire m’aide, parce que l’acte d’écrire construit une distance avec la douleur. C’est d’ailleurs le conseil que donnent des allergologues aux patients en soins palliatifs. Ecrire fait partie de la panoplie des techniques antalgiques. Chester Himes, écrivain afro-américain disait que le fait d’écrire était ce qui préservait sa santé mentale face à la violence raciste dont il était victime physiquement, moralement et mentalement. Les prouesses de l’écriture-antalgique on les retrouve dans ce merveilleux texte de Jean-Dominique Bauby Le Scaphandre et le Papillon, où l’auteur dont les mots étaient le gagne-pain, atteint du LIS (locked-in-syndrome) souffre d’une paralysie totale. Seules ses paupières peuvent se mouvoir et il invente un système ingénieux qui lui permet de dicter son dernier livre, triomphe ultime de l’esprit qui papillonne dans les rêves et les souvenirs sur le corps inerte où il est emprisonné. Y-a-t il un style particulier aux écrivains pour qui l’écriture remplace la parole ou du moins la rend intelligible ? Moi qui ai tellement de mal à m’exprimer oralement, j’ai la particularité d’être une incorrigible bavarde. Donc on peut supposer que lorsque mes paroles ne sont pas ou mal comprises, je me mets à les écrire pour les mettre sous le nez de l’interlocuteur. Ma fascination pour les mots est cosmopolite puisqu’un de mes grands plaisirs est l’apprentissage d’une langue inconnue et que je parle couramment trois langues.
Tu participes régulièrement à Filigranes : F.S-P. : Un des moments importants dans mon écriture a été la rencontre de Filigranes. L’aventure de l’écriture en revue m’a tout de suite enthousiasmée. Au lieu de ne montrer mes textes qu’à un public de parents ou d’amis qui avaient un « a priori » forcément bienveillant, j’allais rencontrer d’autres « écrivants », confronter à d’autres écritures mon style et ma manière de concevoir les mots. En fréquentant le plus possible les séminaires de Filigranes j’ai trouvé un plaisir à écouter l’écriture des autres, à voir fonctionner des échos d’un texte à l’autre. Un plaisir qui tenait à la découverte non programmée d’autres pistes, à l’exploration de terrains nouveaux que je n’aurais pas faite seule. Les écritures d’autrui étaient comme des fenêtres qui laissaient entrer le grand air dans ma propre production, qui me provoquaient, me déstabilisaient d’une manière féconde, me demandaient d’aller plus loin dans ma propre exigence. Oui, c’est ça. Ecrire en revue demande une plus grande exigence par rapport à ce que l’on attend de soi-même. De plus, il y a une différence entre « Ecrire dans une revue » et « Ecrire en revue ». La première fois où j’ai envoyé un texte à Filigranes et qu’il a été publié, j’étais pleine d’une fierté nouvelle et je montrais à tout le monde ce texte imprimé. Puis avec la fréquentation des séminaires, le coude à coude avec les mêmes personnes qui œuvrent pour que Filigranes paraisse contre vents et marées, je me suis rendu compte de ce que c’était qu’ « écrire en revue ». Mon texte était une pierre dans un édifice, il y prenait sa place à des endroits différents, au début, au milieu, à la fin, pour que la construction finale, le numéro de Filigranes, fait de tous ces textes-pierres savamment imbriqués, fasse sens, tienne debout harmonieusement. C’est pour participer à la fabuleuse et minutieuse élaboration de cet édifice, à sa pérennisation, que j’ai voulu faire partie du collectif. Pour défendre l’idée d’une écriture individuelle qui conjuguée à d’autres donne naissance à un objet nouveau, le numéro d’une revue, comme les chromosomes de deux individualités différentes peuvent donner naissance à un enfant.
Cet entretien a été réalisé |
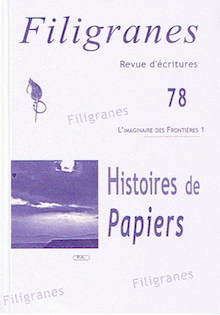 |
|