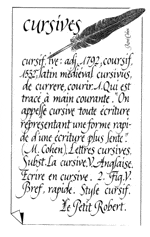|
"La diversité
culturelle
|
|
|
|
Michel Ducom est un militant pour qui l’action pédagogique et poétique sont totalement politiques. Responsable national du Secteur Poésie Ecriture du Groupe Français d’Education Nouvelle (G.F.E.N.), co-éditeur de la revue Cahiers de poèmes, Michel Ducom anime de nombreux ateliers dans sa région bordelaise, organise des formations à l’animation et intervient de plus en plus sur les questions de culture. Contre
l’obsession centralisatrice qui, dans la création comme en politique,
dans l’édition comme dans la critique uniformise et aliène, Michel Ducom
plaide pour la diversité et les multiplicités conquérantes appuyées sur
les concepts de contre-capitales culturelles et d’actions culturelles
contre-centralisatrices.
"On n'est pas le produit d'un sol, A propos d’un parcours
MD :Mon
parcours est celui d’un militant de l’Education nouvelle. Mon engagement
est du côté de la transformation des choses et des gens, du côté de la
transformation des mentalités, de la traque des évidences pour voir ce
qu’elles cachent. C’est une approche humaniste du monde. Filigranes : Comment en vient-on aux ateliers d’écriture ?
MD :
Parce qu’on s’ennuie. Je découvrais à l’époque un GFEN qui ne faisait
que parler, en éducation comme en poésie. Or moi, j’écrivais, j’avais
déjà publié des choses et je voyais bien que cela n’allait pas. Avec une
amie écrivain – Françoise Efel -, la fois suivante, on s’est dit : "Et
si on les faisait écrire ? Et si on montait un atelier!" Ce 1er atelier,
on l’a fait avec la technique du cut-up, à partir du travail de
Burroughs. Nous découpions un journal ou un poème mot par mot et nous
composions un texte inattendu par collage). Il y avait l’idée qu’il faut
s’impliquer pour apprendre, l’idée de Freinet.
La
création du Filigranes : Tu as été un des co-fondateurs du Secteur Poésie Ecriture du GFEN. MD : Non, le Secteur a été créé quelques années avant moi par Michel Cosem. Je me demande si ce n’est pas Jackie Saint-Jean qui a inventé les ateliers d’écriture. Elle faisait alors écrire ses étudiants, à l’école normale de Tarbes. C’étaient des adultes, de jeunes adultes. Elle voulait leur faire comprendre ce que c’était qu’écrire. Elle pensait qu’il valait mieux écrire et faire écrire plutôt que de passer son temps à noter. Filigranes : Le GFEN parle du "tous capables". Qu’est-ce qui se cache derrière ces mots ? MD : C’est la possibilité pour chaque être de se donner des défis incroyables, puis de changer de posture, de devenir mobile et d’accroître sa mobilité en aidant les autres. C’est être intelligent tout le temps, être cultivé le plus possible, c’est à dire confronté à un endroit où on ne sait pas encore agrandir ce que j’appelle la frontière avec l’ignorance. C’est être tellement cultivé qu’on est de plus en plus ignorant et que l’on sait de plus en plus de choses. C’est être dans un paradoxe permanent et c’est être avec les autres. Le "tous capables" n’est pas du tout intéressant tout seul dans son coin ! Filigranes : Comment en vient-on au "tous capables" ?
MD :
Cette idée que tout le monde peut arriver à faire des choses
extraordinaires, ça m’a permis de renouer avec quelque chose de très
personnel. J’étais, d’un côté, petit-fils d’une ouvrière agricole, fils
d’employé modeste. Mais, par une autre partie de ma famille, j’avais
fréquenté des bourgeois et là il s’est passé quelque chose d’extrêmement
important : très tôt j’ai eu beaucoup de relations humaines, à l’endroit
même où je vivais. Je n’ai pas voulu quitter ma région. Je suis resté
dans la région bordelaise et il m’est apparu que c’était un très joli
combat que de décider de ne pas quitter sa région, d’exister à l’endroit
où on était.
Félix Marcel Castan
MD :
Quand j’ai rencontré Félix Marcel Castan*,
j’ai tout de suite été en prise avec lui. Je me suis rendu compte des
grandes aliénations que j’avais du côté de la culture, moi qui parlais
occitan et dont la culture avait été volée : ma grand-mère a interdit
l’occitan à table dès que je suis entré à l’école maternelle. Je
trouvais en Castan le théoricien qui avait déjà pensé cette question.
Mais
qu’en est-il alors
M.D. :
Le régionalisme n’est qu’une forme affaiblie du centralisme : les
régions sont des entités administratives aux contenus culturels vagues,
avec des histoires compliquées que ne recouvre pas le territoire
"Région". Leur identité reste à construire. Le risque pour les cultures
dites "régionales" - qui sont en fait les grandes cultures de France –
c’est d’être gérées en matière culturelle selon des territoires mal
définis, par des élus souvent mal formés aux questions culturelles,
encore moins que ceux du "Centre". Or elles doivent être prises en
compte dans leur dimension nationale. C’est pourquoi, en matière
culturelle ce ne sont pas les entités "régions" qui doivent être les
moteurs de la culture, mais les grandes contre-capitales culturelles que
sont les grandes villes capables d’agréger autour d’elles de multiples
manifestations et de constituer un interlocuteur à la fois pour le
"Centre" et pour le réseau qu’elles constituent entre elles.
De
la pensée à l’action et… retour : Filigranes : Comment cet engagement se traduit-il concrètement ? Parlons du Festival d’Uzeste1.
MD :
Uzeste, un village de 800 habitants, est typique du point de vue qui
nous intéresse. C’est un événement national pour la presse et la culture
en France depuis plus de 30 ans. D’ailleurs, depuis trente ans le GFEN y
participe. Uzeste fait son travail poiélitique et dans ce cadre nous
posons sans arrêt la question du contre-centralisme. Non pas une
résistance simplificatrice mais une complexification des choses. Uzeste,
c’est Bernard Lubat mais aussi les oeuvriers d’Uzeste, c’est-à-dire
beaucoup de monde qui s’engage. Filigranes : Et le GFEN, les ateliers d’écriture ? M.D. : Oui, les ateliers d’écriture sont un autre exemple de contre-centralisation culturelle. Avec le GFEN on a fait des efforts énormes pour que les ateliers d’écriture s’implantent au plus près des désirs des gens, partout en France, et avant Paris. Dans le sud par exemple. Ce n’est pas parce qu’il fait beau dans le sud, mais parce que, sur le plan culturel, c’était extrêmement important que quelque chose de neuf, d’aussi neuf que les ateliers d’écriture, se développe dans ces grandes capitales culturelles qui ne savent pas à quel point elles sont des capitales culturelles. Des "contre-capitales". Les ateliers sont un genre nouveau. Nous avons inventé quelque chose du type de ce que les Grecs ont inventé avec le théâtre. Nous sommes les metteurs en scène de l’écriture. On fait écrire avec des consignes, des propositions d’écriture mais en réalité on gère du temps, des groupes, des déplacements physiques, de l’espace. C’est une véritable mise en scène. Certains ateliers sont admirables comme une pièce de théâtre, comme une performance plastique. Cela, qui est assez exceptionnel, nous l’avons inventé dans les grandes contre-capitales culturelles de la France. Filigranes : Pourtant la réalité est têtue… M.D. : C’est vrai. Les éditeurs sont à 90 % en Ile de France et dans le 6ème arrondissement. La culture semble pour presque tout le monde être de Paris parce que cela permet des dominations. Mais il est possible de faire autrement : Actes Sud s’est installé en Provence. En région, les tout petits éditeurs sont nombreux. Ils vivent près de chez eux et ont quand même des diffusions nationales. Ils ouvrent des perspectives nouvelles.
L’écriture Filigranes : L’approche contre-culturelle, à laquelle nous souscrivons à Filigranes, ne risque-t-elle pas de nous détourner des facteurs sociaux qui pèsent sur la non-écriture ?
M.D. :
C’est quand même ennuyeux qu’un des grands impensés du 20ème et 21ème
siècle, ce soit cette idée de décentralisation culturelle. Ce qui est
pensé, c’est l’idée de l’exclusion en termes sociaux à l’échelle du
pays, des classes sociales, des groupes.
Le
dialogue des cultures,
M.D. :
Quand de grandes cultures, maghrébines, turques ou grecques, qui sont
proches par ailleurs, se rencontrent, ce sont des dialogues inouïs. Ce
sont des moyens de sortir de l’ennui dans lequel on est. On est dans ce
face à face entre la France et l’Afrique néo-colonisée et là, il y moyen
de se parler d’autre chose. Se parler par exemple de la création, de la
littérature en Europe et donc des troubadours, des poètes pré-islamiques
ou des de cette proto-écriture que sont les chants, les contes et les
mythes traditionnels. Ou bien ouvrir la piste de toute l’influence qu’a
eue la France avec ses cultures différentes, basque comprise, sur
l’Amérique du sud par exemple. Des pistes d’ouverture complexes naissent
de la prise en compte contemporaine des langues et cultures régionales,
pistes qui ont une valeur littéraire, culturelle certaines et qui sont
de nature à renouveler à la fois le discours et les approches du monde. Filigranes : Tout cela est très proche de la pensée d’un Edouard Glissant…
M.D. :
Oui, la démarche d’Edouard Glissant est de ce type. Il l’affirme depuis
des principes de créolisation. L’idée de l’enrichissement réciproque n’a
rien à voir avec le repli sur soi dans les communautés, avec l’ethnicisation
des problèmes, avec l’enfermement nationaliste. Pour Glissant, les
archipels ont besoin de se parler, ils inventent. Les pensées
continentales en revanche ont tendance à écraser. Filigranes : Les conditions, sont-elles réunies pour que ce dialogue des spécificités existe ? C’est certainement lié au développement démocratique des sociétés...
MD :
D’abord, il faut ratifier la Charte Européenne sur les Langues
Régionales. Il commence à y avoir un débat européen sur ces
questions-là. Ensuite, il faut faire de la pédagogie là-dessus. Voilà
pourquoi au GFEN, nous faisons des stages intitulés : "Lire Castan avec
les outils pédagogiques du GFEN". Nous avons besoin d’un travail
pédagogique qui soit un travail politique. Nous avons besoin de nous
former. Même si, de ce point de vue, des avancées ont eu lieu en trente
ans. Par exemple, les écoles qui sont liées à des langues et des
cultures régionales comme Diwan pour la Bretagne, Calandrette pour le
Provençal, Ikachtola pour les Basques, et d’autres. Quelquefois
l’audience est très large, au pays Basque ou en Catalogne ; ailleurs
c’est beaucoup plus minoritaire, mais il n’empêche que ces écoles-là
créent des foyers culturels. Dans ce cadre, l’important c’est moins la
langue que la culture, alors que la langue et la culture ça marche
ensemble. Filigranes : Comment expliquer cette non conscientisation : il y a culture, mais c’est comme si on ne le savait pas… MD : Parce que c’était un enjeu de domination extrêmement important et ce pour des raisons très prosaïques : il fallait bien que les bourgeois parisiens aient des domestiques bretons, il fallait bien que les Auvergnats s’occupent du charbon et du vin pour la région parisienne. A partir de là, le mépris est le seul moyen pour que les choses soient transformées. Ce mépris des cultures a par conséquent une origine sociale et politique. C’est une oppression violente, car on a fait intégrer aux gens dominés qu’ils se méprisent eux-mêmes. L’école de la République a joué un rôle terrible, alors qu’elle souhaitait pourtant sincèrement émanciper.
Les
dégâts
M.D. :
Chez Bécassine par exemple, l’aspect terrible c’est le mépris. Bécassine
est un être primitif, ce n’est même pas une femme ! On ne sait même pas
ce que c’est!
Culture, imaginaire, Filigranes : Si l’on admet que la création est liée à l’histoire d’un sujet, à l’inconscient, à l’imaginaire, n’y a-t-il pas un risque à transformer les questions de création en questions culturelles ?
MD :
Est-ce un danger ou un déplacement de ces questions ? En déplaçant les
questions de création, très proches du sujet et de sa zone privée, vers
le pôle social dans sa dimension culturelle, on va vers un humanisme,
vers la rencontre des êtres humains, vers le dialogue des singularités
et avec l’idée d’universel. L’inconscient semble un concept individuel
mais Freud a défini sa portée universelle. La base même de l’existence
humaine c’est le rapport aux autres, aux langages, à la vie collective.
Nous sommes de telles ou telles particularités, mais aussi membres de
l’humanité. Nos solitudes sont toujours peuplées d’êtres absents ou
proches, d’anciens, de comportements questionnants qui ne nous
appar-tiennent pas toujours. La création individuelle s’articule avec la
création collective. Nous sommes reliés.
Entre culture orale Filigranes : Dans ta création personnelle, tu sembles plutôt du côté de l’impro poétique, du slam…
MD : Je
me suis engagé dans cette voie à la suite de la disparition d’un texte
que j’avais à lire. Un texte que j’ai perdu ou qu’on m’a fauché. Je ne
le savais pas par cœur, je n’ai pas eu le choix ! Je me suis mis à
improviser et cela a marché ! Sous l’angle du rapport à la trace, il y
avait perte. Peut-être l’ai-je fait exprès ! Filigranes : Comment définir alors la culture écrite ?
MD :
L’ensemble des pensées humaines passe aujourd’hui beaucoup par l’écrit.
Je suis là du côté "l’écriture est un produit ordinaire de l’activité
humaine" et je pense à Barthes. Mais on pourrait aussi définir les
choses par ce qui est à côté. Culture écrite s’oppose à culture orale,
mais cette opposition a perdu la bataille. La culture orale pure
n’existe plus, elle est définitivement marquée par l’écrit. Aucune
personne, aucun peuple n’échappe à des choses qui sont écrites quelque
part : des lois économiques, de guerre, morales… La culture écrite
influence le monde entier. Elle influence aussi les autres formes de
pensée.
Finalement,
MD :
Ecrire, c’est se mettre à penser très lentement en revenant fortement
sur sa pensée, c’est se mettre à penser en étant tout seul mais en
peuplant cette solitude de grands
fantômes, de femmes inconnues,
d’enfants passés, d’autres pensées. Cet entretien a été réalisé |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|