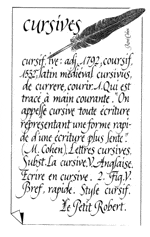|
Une ignorance
jamais comblée
Filigranes :
Vous avez déjà derrière vous 4 recueils de poésie publiés et un livre
écrit en collaboration avec un sculpteur. Y a-t-il eu un moment
inaugural où vous avez pris conscience que vous étiez poète ou bien
est-ce venu progressivement, peut-être grâce en partie au regard
d'autrui ?
José-Flore Tappy : J'ai toujours eu de la peine à me désigner
comme "poète". Le regard d'autrui, l'atten-te qu'on a de vous sont, en
revanche, déterminants, et surtout le Prix C. F. Ramuz de poésie reçu en
1983, qui a entraîné la publication de mon premier manuscrit. À partir
de là, vous devenez pour les autres quelque chose - ou quelqu'un de plus
précis. Mais suis-je "poète" ? Voilà un mot bien trop grand, ou bien
trop petit… On est tant de choses à la fois, et des choses tellement
ordinaires ! Disons que j'écris de la poésie.
Filigranes : Comment définiriez-vous le fait d'être poète ?
est-ce un métier, une tâche, un état intermittent, un mode d'être … ?
J-F.T. : Pas un mode d'être… je dirais un état intermittent.
Comme une sorte de vie parallèle, discontinue, en retrait de la vie
publique. Autant l'activité sociale privilégie la rapidité, la sûreté de
soi, la réussite, la ligne droite, autant l'écriture, elle, s'élabore
dans le doute, le détour, l'inquiétude, à l'écoute des discordances qui
nous fragilisent. Mais c'est la vulnérabilité qui rend humain… Pour ma
part, j'ai toujours eu besoin d'entretenir cette activité souterraine,
lente, patiente, qui permet une communication différée, loin des
pressions extérieures : une communication où les mots, la parole ont le
temps de mûrir.
Lorsqu'on publie, qu'on entre dans le monde du livre et des transactions
éditoriales, écrire devient aussi un métier ; mais je préfèrerais le mot
" travail ", qui dit mieux le labeur, l'effort, l'incertitude, une
ignorance jamais comblée, et la peur devant le vide… " Métier " pourrait
faire croire à un " savoir-faire ", qui n'existe pas…
Filigranes : Qu'est-ce qui peut faciliter l'écriture de textes
poétiques ? quel a été pour vous le terreau nourricier ?
J-F.T. : J'ai beaucoup lu de poésie, souvent en traduction : les
poètes espagnols - Machado, Lorca, Alberti, Jiménez - les poètes grecs,
portugais, latino-américains - la Chilienne Gabriela Mistral, le Neruda
des Hauteurs de Macchu Picchu et des poèmes d'amour, Roberto Juarroz, -
et aussi Kathleen Raine, Emily Dickinson, Anna Akhmatova… et bien sûr
les poètes de langue française. La lecture nous apprend tout. Ceci dit,
je dois à ma profession une distance salutaire et une rigueur
essentielle dans le travail des mots. La formation universitaire m'a
beaucoup apporté : à cultiver la disponibilité d'esprit, à développer le
sens critique, loin des préjugés et des amalgames, à faire preuve
d'exigence. Écouter les œuvres, entendre la voix d'autrui sans la
parasiter, aiguiser son discernement par l'intelligence des textes, tout
cela m'a aidée à trouver ma propre voix.
Tenir les mots devant soi comme des lanternes
Filigranes : L'échange avec d'autres
poètes, avec des lecteurs joue-t-il un rôle important pour vous ? De
quelle façon ?
J-F.T. : Peu… c'est un dialogue que je mène avec moi-même, le
plus loin possible du regard d'autrui. Une fois le livre publié, bien
sûr c'est différent, là les retours sont un grand signe d'encouragement,
et donnent un sens à tout ce temps qu'on a gardé pour soi, passé dans le
repliement et la solitude.
Filigranes : L'activité de recherche que vous menez est-elle un
aiguillon pour l'écriture poétique ou menace-t-elle d'empiéter sur elle,
de la tarir ?
J-F.T. : Non, elle ne la menace pas, ni ne la tarit. Elle la
suspend plutôt. Ce qui entrave l'écriture, c'est une vie active sans
espace vide, sans temps " mort " (on devrait l'appeler plutôt " temps
vif "…), sans retrait possible. Parce que la parole intime naît de ces
interstices où le regard d'autrui n'a plus lieu d'être. Pour écrire, ou
se mettre en condition d'écrire, il faut une qualité de concentration
très particulière et difficile à trouver, une concentration à la fois
flottante et lucide, un état de réceptivité, ou de perméabilité sans
entraves. Après quoi tout commence… parfois sans résultat. La vie
sociale n'a pas de place pour un processus aussi aléatoire.
Filigranes : Ce qui frappe le lecteur dans vos poèmes, c'est à la
fois leur dépouillement et leur densité concrète, souvent aussi leur
polysémie, leur résonance qui se prolonge. Comment naissent vos poèmes ?
est-ce une sensation qui s'impose et cherche à se formuler ? une
alliance de mots ? une disposition mentale qui a besoin de l'écriture
pour s'élucider ?
J-F.T. : Je ne sais pas… c'est difficile à saisir, pour moi. Sans
doute un peu tout à la fois. Je dirais tout de même que la sensation de
départ est un levier majeur, mais que l'émotion, souvent trop forte,
trop douloureuse, trop vive, a besoin de se construire pour être
traversée. Rien de cartésien ni de très rationnel, au contraire : une
plongée dans l'obscur, tâtonnante et peu sûre. Les mots sont un peu des
lanternes, des falots qu'on tient devant soi pour avancer et tenter de
voir.
Je pense souvent à cette formule d'Edmond Jabès : " remonter la filière
de l'opaque… ". C'est exactement cela.
Il faut que les poèmes m'habillent
Filigranes :
L'importance dans vos poèmes des sensations tactiles, des
expériences corporelles, correspond-elle à votre rapport au monde ou
est-ce le désir de contrecarrer ce que le langage peut avoir d'abstrait,
d'évanescent ?
J-F.T. : C'est une manière de vivre le monde, j'ai besoin de le
ressentir physiquement avant de pouvoir le penser. Les mots me viennent
d'abord du corps, d'un rapport très empirique aux choses, avant de
passer à une forme plus réfléchie.
Dans sa fulgurance, le poème, cette unité de temps plutôt brève, devrait
à mes yeux restituer la pointe aiguë d'une émotion, sans détour
discursif. J'aimerais pouvoir noter les choses avec le moins de distance
possible entre la réalité, le lecteur et moi. Il y a là une forme de
mimétisme corporel, il faut que les poèmes m'habillent, que je les sente
autour de moi, pas seulement dans ma tête ; je les enfile, je regarde si
ça va ou pas, s'ils sont seyants, ni trop grands ni trop étroits. C'est
comme le vêtement d'un état d'esprit que je veux retrouver, éprouver.
La silhouette du poème sur la feuille, sa place dans le livre doivent
aussi répondre à une nécessité impérieuse : j'hésite longtemps avec les
coupures, les rythmes, les enchaînements, le martèlement des mots,
jusqu'à ressentir comme une percussion sur la page, même douce. J'aime
la parole dans l'espace, une parole charnelle, même si elle devait être
frugale…
Filigranes : Certains de vos poèmes sont très riches en images,
d'autres en sont presque dépourvus. Que pensez-vous du rôle de l'image
dans l'expérience poétique ?
J-F.T. : J'ai, comme beaucoup, un rapport très ambivalent aux
images. Elles s'imposent à moi soudainement et me donnent envie
d'écrire. L'image est donc vitale, elle met en mouvement. Mais elle est
aussi parfaitement insuffisante, et parfois trompeuse : on la croit
originale alors qu'elle est tout à fait convenue, elle devrait ouvrir la
pensée alors qu'elle la clôture, elle fixe l'imaginaire au lieu de le
relancer. J'aime les images, et m'en méfie. Disons qu'elles sont un
point de départ - jamais un but, une finalité.
Dans l'expérience poétique, le recours aux images répond, je crois, à
une nécessité existentielle profonde, celle de colmater une faille, de
réparer un monde déchiré. En rapprochant par une sorte d'étincelle des
choses disparates ou différentes, la métaphore les fait entrer en
connivence. C'est le vieux rêve d'un monde unifié, où tout s'appelle et
se répond… Ce rêve, il nous taraude, dans l'inconscient.
Une inquiétude rugueuse
Filigranes : Vous semblez influencée par les haïku, dont certains de
vos poèmes ont la brièveté et l'absence de partis pris, mais par
ailleurs vous n'hésitez pas à dire " je " et, notamment dans Terre
battue, à donner accès à une expérience qui semble très intime : y
a-t-il pour vous alternance entre retrait en soi et observation du monde
ou s'agit-il de deux faces indissociables d'une même écriture ?
J-F.T. : J'ai lu, bien sûr, les haïku, mais m'en sens au fond
assez éloignée. Je m'implique trop personnellement, et avec une
véhémence parfois qui n'a rien d'asiatique ! En revanche, je cherche
toujours à dépasser le " moi " biographique. Il y a une quête de
l'impersonnel, pour moi, dans l'écriture, un " je " qui tendrait presque
à l'anonymat.
Pour transmettre une émotion, - non la communiquer, mais la transmettre
- je dois dépasser mon individualité, la dépouiller de tout ancrage
anecdotique, et chercher l'autre en moi qui va donner à mon vécu sa
dimension de partage. Trouver la bonne distance avec ce " je " intime,
c'est à cela que le travail d'écriture m'oblige, me contraint. Si on y
parvient, on se tient compagnie avec beaucoup plus d'aisance, on
retrouve un équilibre. La poésie préfigure quelque chose, le joue, et
par cette représentation le répare.
Filigranes : On ressent parfois une osmose entre le paysage et
l'humain : le paysage est un corps, le corps devient paysage, le soi et
le monde s'interpénètrent. Y a-t-il pour vous des paysages matriciels,
qui vous touchent intimement ?
J-F.T. : Les paysages désertés, ou les plus pauvres.
Filigranes : On est sensible en vous lisant à une certaine
violence génératrice de souffrance : l'écriture joue-t-elle pour vous un
rôle cathartique ou est-elle plutôt du côté de la dénonciation ou au
contraire de la quête d'une certaine paix ?
J-F.T. : L'intensité d'une émotion, même heureuse, a quelque
chose de violent, et d'anarchique. L'indignation, la révolte, un
sentiment d'impuissance face au monde ont besoin de s'exprimer ; alors
j'aligne mes mots comme des cailloux. Je peux comprendre les jeunes qui
lancent des pierres dans les vitrines. Comment parler parfois ? se faire
entendre ? traverser un mur d'indifférence ? Il m'arrive de vouloir
serrer mes mots comme des poings, à d'autres moments je voudrais leur
donner la légèreté d'un murmure. Cette violence, les mots vont
s'efforcer de la pacifier ; pas la refouler ni l'atténuer, juste l' "
orienter " en lui donnant un lieu, un gîte où s'abriter.
Il y a aussi un préjugé de l'unité intérieure. On est divisé, complexe,
paradoxal. Écrire serait une tentative de coordonner ces parts de soi
qui se déchirent, de les écouter, de transformer leur fragilité en
force, en cohésion. Henri Michaux a cette belle formule: " on veut trop
être quelqu'un " (dans la postface de Plume) ou encore celle-ci que je
ferais volontiers mienne : " Moi n'est qu'une position d'équilibre, un
mouvement de foule. Je signe ce livre au nom de beaucoup ". C'est
magnifique !
Chercher l'autre en soi
Filigranes
: Quelle place occupent les mythes dans votre recherche ? ils semblent
présents en filigrane, de sorte que votre poésie allie souvent la
simplicité du quotidien et la force élémentaire des mythes.
J-F.T. : Je ne réfléchis pas " culturellement " quand je
travaille, et n'ai pas d'intentions. Cela dit, on est imprégné de cette
culture, elle nous modèle et nous structure inconsciemment. Mais quand
j'écris, je n'ai aucune " visée ", aucun sujet. C'est là ma limite, ma
grande difficulté, et l'une des raisons, peut-être, de la rareté de mes
livres.
Cependant les mythes, parfois, rencontrent la vie, et viennent à sa
rescousse. Ce ne sont jamais des projets esthétiques, ou thématiques.
Juste un écho à une expérience existentielle, qui m'aide soudain à la
formuler de manière plus universelle (en me dégageant précisément de
l'emprise du biographique). Par exemple, la femme de Loth à qui est
dédiée la première partie de Terre battue. Changée en statue de sel pour
avoir regardé derrière elle, elle a figuré de manière emblématique une
expérience intime : la nostalgie pétrifie. Pour continuer à vivre,
surmonter une perte, une rupture intérieure, aller de l'avant, il
faudrait parfois oser tout lâcher, se quitter. La terrible tentation de
s'accrocher au passé, de vouloir retenir ce qui s'éloigne, voilà un peu
le thème de Terre battue. Et dans le mythe biblique, les figures de Loth
et de sa femme fuyant Sodome en feu, l'un marchant droit, l'autre se
retournant pour voir une dernière fois la maison qu'elle abandonne, mue
par une déchirante nostalgie, m'impressionnent. On peut s'identifier
tour à tour à chacun d'eux.
Le vent, dans la deuxième partie, représente peut-être ce mouvement
nécessaire, à la fois rassérénant et menaçant, respiration vitale et
précarité de toutes les certitudes.
Filigranes : On sent dans Lunaires un rythme parfois plus ample
et plus véhément que dans Terre battue : est-ce dû à l'origine de ce
recueil, né d'une collaboration avec un musicien ?
J-F.T. : L'origine du livre a été un travail dramaturgique.
D'abord la traduction en français du Pierrot lunaire de Schönberg
d'après le livret allemand d'Otto Erich Hartleben, ensuite la création
d'un nouveau " Pierrot lunaire " mis en musique par le compositeur
Jacques Demierre. J'ai écrit 21 poèmes, intitulés Pierre eau lune air,
de manière tout à fait autonome et recluse, le compositeur créant la
musique ultérieurement, à partir des textes achevés. On ne peut donc pas
vraiment parler de collaboration, mais plutôt de destination. Le fait
d'écrire pour la scène, et une scène lyrique, de confier mes textes à
une voix humaine, à des musiciens et des instruments, cela a sans doute
conditionné l'intonation des poèmes, leur a donné une ampleur que
probablement je n'aurais pas osé pour moi seule. Je suis sortie d'une
certaine retenue.
Le livre ensuite s'est construit très différemment, les 21 poèmes
initiaux en ont fait naître d'autres, tout a changé, mais il est resté
sans doute quelque chose d'une sonorité plus libre, ou plus émancipée,
en tout cas moins confidentielle qu'à l'accoutumée.
Filigranes : Qu'apporte à votre poésie le contact avec d'autres
formes d'art (musique, arts plastiques) ?
J-F.T. : J'aime tous les arts plastiques, mais particulièrement
la sculpture, pour ce corps à corps avec la matière, pour la puissance
des éléments d'atelier proches de l'univers ouvrier - poussière, plâtre,
bronze, fer, marteaux, gradines, feu… -, pour cette tension permanente
entre la structure et la masse, l'épure et l'élémentaire. Il y a comme
une inquiétude qu'on peut toucher, rugueuse, pleine d'aspérités.
Filigranes : Votre poésie semble à certains égards plus
méditerranéenne qu'helvétique ? est-ce dû à des circonstances de votre
vie ou à votre imaginaire personnel ?
J-F.T. : Les deux à la fois (car tout se tient, en vérité, - les
faits, le destin, l'imaginaire…). Ce qui m'interpelle toujours dans
le paysage méditerranéen, c'est qu'il n'a rien de paradisiaque,
contrairement aux idées reçues : dur, aride, brûlant, il sollicite une
réponse vigoureuse, une attitude de résistance.
"Remonter la filière de l'opaque… "
Filigranes : Comment composez-vous
vos recueils ? l'organisation est-elle pensée d'emblée ou naît-elle peu
à peu ? Avez-vous en tête des destinataires précis ?
J-F.T. : Non, je n'ai en tête ni destinataires ni destination. Je
vis longtemps sans rien noter, sans idée préconçue, laissant la vie se
déposer en moi ; puis, presqu'à mon insu, des bribes de perceptions, de
sensations accèdent au langage. Je me mets alors à noter, sur n'importe
quel support, sans plan ni méthode, parfois durant plusieurs années…
S'accumule ainsi tout un matériau hirsute, désorganisé, sauvage, non
contrôlé. Comme une semi-conscience qui viendrait s'archiver sous mes
yeux et sur laquelle finalement je vais travailler.
J'avance ainsi de manière incohérente, triant une poussière verbale
informe, sans savoir ce qu'il en adviendra: il s'agit seulement de
trouver des repères dans une sorte de vagabondage désorienté à
l'intérieur de soi. Les situer de manière provisoire : chaque poème est
pour moi comme un auvent, un abri transitoire pour poser mes outils.
Brouillons, ratures, corrections, tout doit rester visible jusqu'au
dernier moment. Une sorte de palimpseste infini… Ces couches
successives, ces strates m'enveloppent, posent comme un brouillard
autour de moi, ou comme un filet serré de mots tendu sur le vide, à quoi
je m'accroche.
Filigranes : Vos poèmes n'ont pas de titre : est-ce parce qu'ils
ne sont que des éléments d'un ensemble plus large, doté lui d'un titre
ou d'un numéro ?
J-F.T. : C'est que les poèmes ne sont pas écrits séparément les
uns des autres. Ils avancent tous à la fois, parallèlement. Comme un
seul texte, que j'aurais fragmenté sur soixante pages. Je travaille
énormément la construction du livre : le passage d'un poème à l'autre,
leurs transitions, leurs contrastes, - et cherche longtemps la plus
grande tension possible entre eux. Les poèmes ne sont pas des unités
séparées. Au fond, ils racontent une histoire… Un titre leur donnerait
une autonomie, une indépendance qu'ils n'ont pas. Idéalement, je
voudrais qu'on puisse lire mes livres de la première à la dernière page,
dans un mouvement linéaire. A cet égard, je ne fais pas grande
différence entre la prose et la poésie. Un recueil est un texte qui se
projette en plusieurs éclats, un peu comme les pulsations du cœur.
Je voudrais (mais est-ce que j'y parviens vraiment?) tendre les poèmes
d'un livre comme une corde, et que les silences - tel l'air autour d'un
fil, d'un câble - les fassent vibrer en suspension.
Filigranes : Quand savez-vous qu'un poème est terminé ? vous
arrive-t-il de retoucher un poème quand vous relisez les épreuves, ou
quand vous rééditez un recueil ou préférez-vous ne plus regarder en
arrière ?
J-F.T. : Au moment d'une réédition, il est très rare que je
retouche. Mais sur épreuves, avant la première publication, oui, tout
bouge jusqu'à la fin. C'est un état de veille permanent, presqu'une
insomnie, jusqu'à l'impression. Le livre seul peut m'arracher au
manuscrit, et marque un cran d'arrêt dans ces sables mouvants.
Filigranes :Du
point de vue littéraire, définiriez-vous la Suisse comme une île ou
comme un carrefour ?
J-F.T. : Un carrefour , avec de multiples
passerelles entre les régions, les langues, les cultures. On est
rapidement dépaysé en Suisse, une centaine de kilomètres et on peut se
sentir à l'étranger dans son propre pays, comme on peut se sentir chez
soi avec des compatriotes qu'on ne comprend plus…
D'où l'importance du " relatif " et de la différence. Il est difficile
en Suisse de cerner un esprit national (et c'est tant mieux). On est
constamment amené à comparer, à distinguer, à traduire, à déchiffrer… De
nombreux écrivains suisses sont d'ailleurs d'excellents traducteurs.
Filigranes : Est-il facile de concilier l'activité
professionnelle et le travail d'écriture ?
J-F.T. : Il faudrait ajouter la vie familiale… mais là c'est un
vaste sujet ...
Propos recueillis
par Michèle Monte

|
|
|